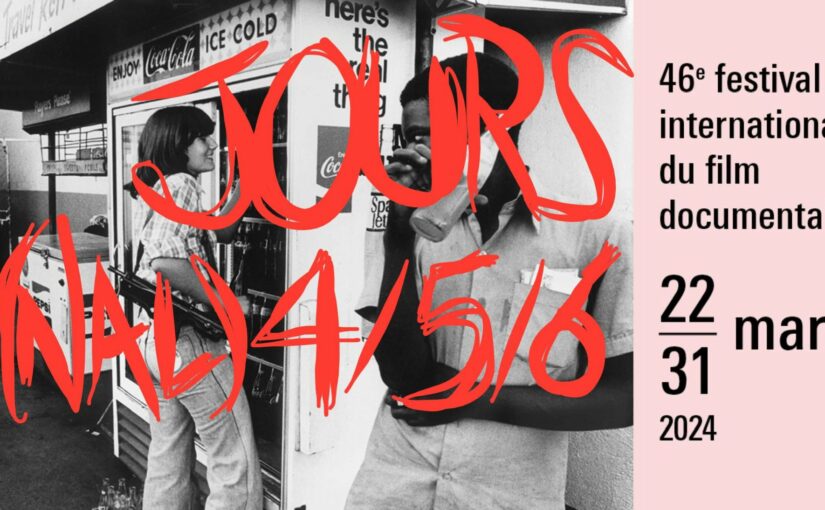Jour(nal)s de bord : 4, 5, 6
Ça a continué comme ça. Un très grand film et puis un autre (dont un très long). Un épuisement, un nombre de papiers à écrire conséquent et un chef de rédaction qui me demande d’ajouter des intros à mes journaux. Je ne lui en veux pas, il s’inquiète de mon état. Et puis au fond, plus j’en écris, plus il doit en relire avant publication… Le travail qu’il me rajoute, finalement il se le rajoute aussi.
L’atmosphère du centre Pompidou me plait bien. Les promeneurs et spectateurs sont très beaux. Les promeneuses et spectatrices sont très belles. Quand ce ne sont pas les films qui happent mon regard, les humains font l’affaire. L’ambiance d’un festival est toujours un jeu de regard. Toutefois, la fatigue piste plus mon quotidien que les rencontres.
J’ai écris et je commence à y voir clair. Les œuvres qui retiennent mon attention sont celles qui ne cherchent pas à la retenir. Avais-je besoin du réel pour l’apprendre ? Voyons plutôt ça comme une confirmation et poursuivons le chemin. On fera le bilan plus tard. Pour l’heure, j’ai une séance qui m’attend. Je vous laisse sur ces quelques gribouillis de pensées.
Lundi 25 Mars
Sous les feuilles (2024) – Florence Lazar
(61 minutes, Pompidou Cinéma 1)
La croyance fait la consistance. Certains endroits, certaines situations, ou autres cultures, amènent inlassablement les individus à trouver quelques issues dans l’irrationnel. Celui-là même, intangible, que l’on prend de la plus profonde et de la plus ancrée région, cette bien nommée nature. Sous les arbres et sous les plantes se trouvent les vivants de passage. Sous les feuilles est ce petit groupe d’humains que la guérison obsède. La disposition des séquences dissémine un fil narratif explosé qui, de là, se retrouve lacé d’aléatoire et d’humeur dans un environnement (social et esthétique) en quête de repères et en attente de sens. Une catastrophe naturelle (encore la même) passe et tout un monde doit se réorienter. Le cyclone Dean en Martinique en a même craché des poissons sur le bitume, les passages piétons, des passages nageoires. Au cœur du territoire, tout semble perdu. La foi et le mysticisme sont des réponses accessibles pour quiconque en aura le besoin. Florence Lazar vagabonde en quête de témoignages, de rencontres et d’apaisements. Son projet filmique prend une ampleur inspirée à partir du moment où l’on accepte ce fatras de peur, ce désordre fruit de craintes et d’appréhensions. Vivre Sous les feuilles, c’est accéder à la réponse artistique qu’une racine poétique peut faire pousser.
Silence of Reason (2024) – Kumjana Novakova
(63 minutes, Pompidou Cinéma 1)
Ressasser les horreurs a ce bizarre et pervers effet de les exposer au grand jour comme une nécessité, puis (potentiellement) d’agir contre leur reproduction. C’est tout le paradoxe étonnant de l’humanité : reproduire pour ne pas reproduire. Silence of Reason est probablement le film le plus dur, le plus sombre et le plus froid de la compétition à ce jour. Il est celui de l’oxymore filmique. Cloîtré dans l’obscurité lumineuse et figée du numérique, révélateur de certaines voix bâillonnées, il est la photographie contradictoire des tribunes et du voyeurisme. Cependant, Novakova, de ce nœud perpétuel, en tire un grand film. Elle use de ces paradoxes multiples pour tenir tête et reprendre force là où les violences des puissants s’étaient accaparées toutes les sorties de secours. Elle construit un mur opaque d’images (VHS et photographies, pièces à conviction, camps de Foca, guerre de Bosnie-Herzégovine) qui ferme enfin la fuite des sadiques. Nous sommes confrontés aux infamies, ces laideurs du monde qu’il faut maintenant assumer, et nous sommes démunis, dégoûtés par la cruauté des hommes. Après la projection, ce que nous appelions humanité n’a plus aucun sens. La guerre n’a aucune excuse – rien ne servira donc dans crier des « soutiens inconditionnels » dans tous les médias ; nous ne souhaitons plus ce piège.
O Panama (1986) – James Benning
(28 minutes, Pompidou Cinéma 2)
Il serait tout à fait impensable de visionner O Panama et d’en deviner d’un coup d’un seul son cinéaste, tant son style est lointain (voire peut-être même contraire) à ce que Benning a pu ensuite créer, former et instaurer stylistiquement. Peut-être seul film du réalisateur américain où un acteur joue (et pas des moindres, Willem Dafoe, dont on connaît le plaisir d’être hors de l’industrie classique et hollywoodienne : Abel Ferrara, Nobuhiro Suwa, Tessa Louise-Salomé, Theo Angelopoulos…), O Panama tombe dans le piège que les autres films de Benning ont su éviter : surfaire le réel et accentuer grossièrement les états psychologiques du vivant. En ce sens, nous comprenons celui que Benning a pris par la suite. Épurer au paroxysme toutes traces d’intériorité, au profit de l’extérieur, des paysages et de leurs contenus secrets. Néanmoins, ne soyons pas trop exigeant (notre déception est biaisée par le temps qui s’est écoulé entre 1986 et 2024) et remarquons la véritable qualité de O Panama, c’est-à-dire sa puissance rythmique et son sens du montage. James Benning, par cette tentative fictionnelle et étonnante (un homme rumine dans un lieu clos, rêvant en faisant les cent pas, patientant en déprimant), ouvre la voie d’un possible contrat entre la facticité et l’ampleur de la lenteur. On ressort du court-métrage avec cette nette sensation d’avoir vécu une belle expérience, quand bien même nous en percevons les limites, ce caractère de l’état d’âme que le cinéma ne saura jamais reproduire parfaitement (et tant mieux).
Direct Action (2024) – Guillaume Cailleau et Ben Russell
(216 minutes, Vidéothèque)
Mardi 26 Mars
Arancia Bruciata (2024) – Clémentine Roy
(74 minutes, Vidéothèque)
L’oisiveté est un Dieu qu’aucun monde n’a encore reconnu. Aucun ? Laissons Clémentine Roy démentir l’idée par la force d’une forme nouvelle. Proposition inactive (dans le noble sens du terme) et céleste (dans son sens le plus littéral possible). Quelques moutons dans l’eau, une pastèque pour un cheval, le tracé coloré des oiseaux… Ici, la vie terrestre s’expose délicatement, le silence est son garde, son saint patron. L’étrangeté qui hante Arancia Bruciata réside dans sa paisible apesanteur. La légèreté qu’un simple hamac peut offrir. Jamais la possibilité d’un autre rythme de vie, d’une autre société, s’était installée sur un écran avec autant de sérénité et de bien-être. Les cris de souffrance ne résonnent pas même au loin, aucun hurlement de mécontentement – on se laisse aller et on sieste, c’est tout, et c’est déjà beaucoup ! C’est grand, fort et, sans l’accentuer, puissamment politique. La nature est stable, quiète d’une affection et d’une entraide sans équivalent. Ce lieu où s’est installée la petite communauté de marginales que le film nous montre sans grandes présentations (et tant mieux) semble provenir d’une autre planète, tant il apaise nos esprits en nourrissant nos contenances. Nulles précipitations là où les bruits de la faune et le cadre de la flore nous élèvent. Notre patience transmue en une lévitation contemplative, l’état pur d’une véritable expérience cinématographique heureuse, aboutie et remarquable.
The Roller, the Life, the Fight (2024) – Elettra Bisogno et Hazem Alqaddi
(85 minutes, Vidéothèque)
Le papier d’Olivia Cooper-Hadjian a déjà tout dit.
Il n’y a rien à ajouter.
Modèle Animal (2024) – Maud Faivre et Marceau Boré
(51 minutes, Forum des Images)
La fourmi qui gigote dans un cercle au début du film résonne drôlement avec l’œil culte de la lune de Méliès. Les plans suivants, désertiques, font eux écho aux designs numériques et modernes des jeux vidéos de notre temps. Où sommes-nous ? Quelle est cette tentative formelle faite d’un siècle et de centaines de bestioles ? Suresthétisation des cadrages, amplification des lumières, images léchées et prises sons bien trop propres, radicalement clean… Les seuls parasites du film ne sont pas des bruits, non, ils sont des prisonniers enfermés dans des boîtes bien rangées. Un zoo miniature. Puis, monochrome jaune, changement de décor. On passe d’un plan d’ensemble sans mouvements à un plan rapproché, un gros plan, fait de mains pressées, gesticulant de parts et d’autres du cadre. Puis, monochrome rose, changement d’ambiance. Les photogrammes de Modèle Animal feraient un si beau contenu Instagram qu’on serait prêt à le recommander à A24, tant la boîte américaine mise sur ce genre de proposition informe et tape-à-l’œil. Une mosaïque de m’as-tu-vu. Mais la démarche (vous l’avez compris) rate l’éblouissement, elle frappe à-côté et nos yeux vomissent tous ces monochromes pét(d)ants qui rappellent étonnamment (mais pas tant que ça) celui rouge de La Zone d’Intérêt (Jonathan Glazer, janvier 2024). Malheureusement pour les deux films, leurs sujets nous passionnent plus que leurs vaines tentatives plastiques qui, toutes deux finalement, ne vont pas plus loin que ce lieu clinquant où voler la vedette aux victimes de ce monde est un chic pour les snobs dénués d’exigence.
Mercredi 27 Mars
Capture (2024) – Jules Cruveiller
(39 minutes, Pompidou Cinéma 1)
C’est toujours la même histoire : la voix-off délaisse l’image et prend toute l’attention, toute la conscience, provoquant le triste résultat d’une illustration à l’inspiration relative. Le travail sonore en revanche est réjouissant. L’atmosphère auditive craque les apaisements, ouvre les chemins anxiogènes, stimule l’expérience tout en décorant de tensions la narration contée. Le projet de Cruveiller est de retranscrire tendrement et amicalement un vécu, un récit hors du commun (celui de Cihan, ancien prisonnier politique kurde en Turquie). Il le fait avec attention, préservant son ami, et il le fait d’une voix délicate. La limite de l’écoute relève de notre regard. À chaque silence, la concentration visuelle réapparaît, toutefois la déception gagne. Les gestes attendus de l’objectif s’éteignent là où les images tuent les plans, et les symboles le cinéma. Certains traits sont trop appuyés, trop forcés, comme pour nous dire « voyez-vous comme le lien fait sens ? ». Nous aurions préféré le trouver nous-même et avoir de la place pour cela – ne pas être enfermé dans la capture du sens. Retenons-en, tout de même et tout compte fait, la valeur de la parole.
Light, Noise, Smoke and Light, Noise, Smoke (2024) – Tomonari Nishikawa
(6 minutes, Forum des Images)
On en redemanderait bien une heure, tant l’effet de ces quelques minutes implante une espèce d’hypnose captivante et agréablement fantasmagorique. Un simple enchaînement de lumières sur un fond profondément noir, et toute l’Histoire de l’image animée déferle. Nishikawa dans tous ses courts-(très courts)-métrages joue de la simplicité des procédés pour structurer une synthèse de son art (de ce qu’est essentiellement le dit Cinématographe). 16-18-4 réfléchissait les photogrammes, Tokyo-Ebisu le mouvement façon frères Lumière, 45 7 Broadway la couleur, Ten Mornings Ten Evenings and One Horizon le montage. Les feux d’artifices de Light, Noise, Smoke and Light, Noise, Smoke questionnent ensemble la réflexion (dans tous les sens du terme). Car la grandeur des films de Nishikawa est toujours l’horizon ouvert de pensées et de méditations. Quand le film s’achève, un large sentiment de solitude fait miroir sur notre propre place ici, notre existence dans le monde, mais plutôt et surtout dans la salle de cinéma.